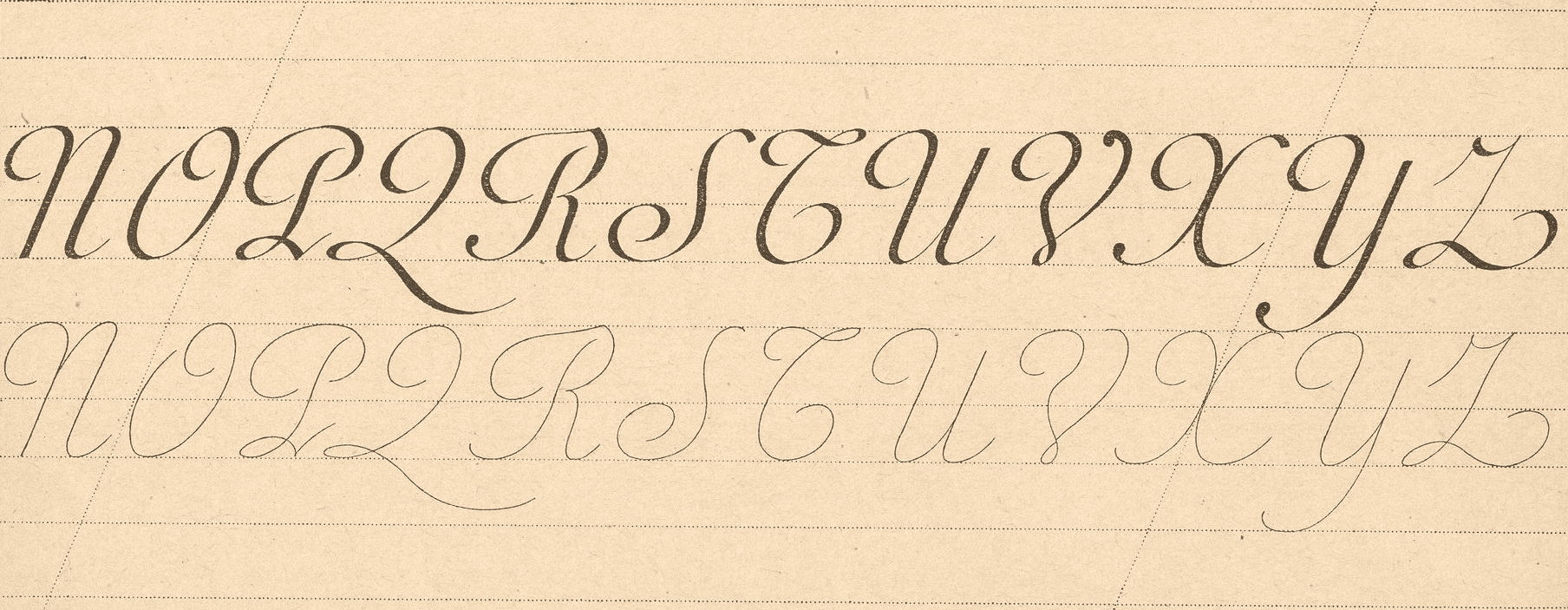Faire de l’histoire c’est, quoi qu’il arrive, se trouver à un moment ou un autre devant un clavier et un écran pour écrire.
Il existe parfois, dans nos formations, des ateliers d’accompagnement à l’écriture d’un mémoire de Master par exemple, mais dans l’ensemble il ne me semble pas déraisonnable de considérer qu’en histoire, on n’enseigne pas l’écriture. Son apprentissage, dans ses dimensions argumentatives, d’administration de la preuve, etc. est surtout indirect. Nous écrivons des textes que nous donnons à lire à nos enseignants, puis plus tard à nos collègues, nous soumettons des articles à des revues, des ouvrages à des éditeurs… et nous apprenons progressivement à écrire un peu mieux, sur la base des commentaires, des propositions de reformulations [1] S’il est, en revanche, une dimension de l’écriture pour laquelle le déficit de formation me semble encore plus important, c’est bien celle qui relève des instruments. La dimension proprement matérielle de l’écriture est pourtant loin d’être anodine.
La littérature n’a pas attendu les sciences humaines et sociales pour s’en préoccuper [2]. Je pense en particulier à deux auteurs qui, au milieu des années 2010, ont entrepris de penser les transformations de leurs propres pratiques: François Bon et Thierry Crouzet. Les deux extraits qui suivent sont ceux que j’aime faire lire aux étudiants en histoire lorsque j’ai l’occasion de proposer une séance de formation aux outils d’écriture.
Ce que ces deux écrivains ont à nous dire de l’importance de la dimension technique de l’écriture et de son intrication à l’écriture tout court mérite notre attention. Je vous les livre ici sans commentaires, en vous invitant simplement à remplacer « littérature » ou « écrivains » par « histoire » et « historiens/historiennes »:
Alors pourquoi évoque-t-on si souvent l’influence de la technologie sur les arts plastiques ou la musique et presque jamais sur la littérature ? Les écrivains seraient-ils au-dessus de la mécanique, indifférents aux particularités de leur temps ? Il suffit de les lire pour comprendre le contraire. Il m’a suffi d’écrire, d’abord à la main, puis avec un ordinateur, puis avec une variété d’interfaces numériques pour éprouver, au plus profond de moi-même, que l’outil imprègne ce que nous écrivons et ce que nous lisons, seulement c’est moins apparent, plus discret… Si bien que beaucoup de gens ignorent, ou même nient, l’influence de la technologie sur l’écriture et la lecture.
Thierry Crouzet, La mécanique du texte (extrait de « quand la technologie se voit »), publie.net (puis Thaulk), 2015
« Trop de technique ? Pas possible de la contourner: les dénominations parfois étranges, les flux rss des agrégateurs (…), l’établissement de normes pour le format epub (…) par rapport à nos exigences en terme de forme littéraire, et les appareils eux-mêmes – on n’oubliera pas un iPad sur le sable d’une plage comme on le pouvait du vieux Simenon mille fois relu –, ils ont leur place ici. A-t-on besoin de ce charabia technique pour réfléchir, et surtout s’il s’agit de littérature ? Toute son histoire elle a rejoué ce conflit – le vocabulaire du corps quand il s’installe chez Rabelais ou celui de la locomotive quand il emporte Zola. Un double mouvement: se saisir ‘du code’, c’est assurer notre liberté d’auteur quant aux formes matérielles de ce qu’on écrit, donc oui, approprions-nous le vocabulaire des flux et formats comme les auteurs de la Renaissance se sont saisi de la page imprimée et son vocabulaire, et de ce qu’il changeait à l’idée même du livre.
François Bon, Après le livre (extrait de l’introduction), Tiers Livre Éditeur, 2014
Comment tenir compte de ces dimensions dans la formation des étudiants en histoire et, plus généralement, en sciences humaines et sociales ? Quels outils, quelles démarches enseigner alors qu’en dépit de leur caractère parfois inadéquat, ce sont les logiciels de traitement de texte qui dominent encore bien des usages ? L’objet de ce billet est de partager quelques réflexions à ce propos, à partir de mes propres expériences d’enseignement, et donc d’un point de vue situé, partiel …et forcément partial.
Faut-il en finir avec le traitement de texte ?
Il y a maintenant deux ans, Marcello Vitali-Rosati, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques à l’Université de Montréal, publiait un article au titre provocateur: « Les chercheurs en SHS savent-ils écrire ? » [3]. Associé à diverses prises de positions plus ou moins heureuses concernant les humanités numériques, ce texte avait suscité quelques réactions agacées, voire servi de prétexte (s’il cela était nécessaire) à s’enfermer dans un refus de toute discussion relative aux usages savants du numérique en sciences humaines et sociales.
Pour autant, au-delà du ton provocateur de l’article, les questions que posaient M. Vitali-Rosati méritaient et méritent encore d’être posées. Je ne partage pas l’idée selon laquelle écrire avec un traitement de texte serait le révélateur d’une incompétence, quelle qu’elle soit. Notamment parce qu’il suffit de faire l’expérience d’une demande de fichier de bibliographie structurée à des auteurs supposés rompus à l’usage de LaTeX, du XML voire même simplement de Zotero pour constater que, de l’abandon de « Word » à la maîtrise réelle des instruments permettant de structurer son écriture (et donc sa pensée), il y a parfois un gouffre. Mais, en même temps, on peut s’inquiéter du fait que des candidats à ce qui demeure des métiers de l’écrit puissent atteindre le niveau Master, voire Doctorat, sans jamais avoir ne serait-ce qu’entendu parler de structuration de l’écriture ou de balisage (qu’il soit léger ou non). Inquiétude qui ne saurait être diminuée par le refus, parfois revendiqué par des universitaires, de toute prise en considération de ce que nos environnements techniques de travail font à nos pratiques de recherche et d’enseignement, dans l’oubli plus ou moins volontaire de l’ordre matériel du savoir.
Il me semble, en outre, qu’il ne faut pas totalement déconnecter cette absence de la position dans laquelle sont généralement relégués les enseignements méthodologiques dans nos disciplines… non seulement ceux qui relèvent de l’appropriation de l’environnement numérique dans lequel nous évoluons; mais aussi ceux qui renvoient simplement aux pratiques les plus fondamentales de nos disciplines, ne serait-ce que la construction et la restitution d’une argumentation. Pour le dire autrement, il y a en général plus de monde pour déplorer le niveau de nos étudiants en la matière que de titulaires candidats aux charges de cours de « remédiation » en pratique de l’écrit, en particulier s’ils sont dispensés en premier cycle.
Apprendre à utiliser correctement un traitement de texte me semble toutefois aujourd’hui encore indispensable. Pas forcément pour en défendre un usage exclusif et/ou immodéré; plutôt pour prendre acte du fait que, qu’on le veuille ou non, le traitement de texte reste une norme, et qu’il est de notre responsabilité de faire en sorte que celles et ceux que nous formons soient en capacité, non seulement de l’utiliser, mais de l’utiliser correctement. Une telle position est avant tout pragmatique et ne conteste absoluement pas les arguments, très souvent pertinents, de celles ou ceux qui appellent à « en finir avec Word ». Mais puisqu’en l’état actuel des usages universitaires le passage par un .docx (ou, plus rarement, par un .odt) reste courant, autant savoir intervenir dans de tels fichiers.
Pragmatisme et stratégie du « c’est toujours mieux que rien »
Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille abandonner tout espoir de former les étudiants à la structuration de leurs écrits; il faut en revanche savoir d’où l’on part. Mettons juste un instant de côté l’obstacle majeur à un enseignement vraiment complet en premier cycle (i.e. les maquettes et le volume horaire que collectivement nous acceptons ou non de consacrer aux enseignements méthodologiques). Si l’on considère qu’une formation de deuxième cycle universitaire dans une discipline de sciences humaines et sociales devrait sanctionner l’acquisition de compétences solides en termes de balisage sémantique (maîtrise de l’HTML et du XML par exemple), alors il faut introduire la notion bien plus tôt, au moins dès les premières années de formation supérieure.
Revenons à notre réalité: dans la plupart des formations de Licence en Histoire par exemple, ce n’est tout simplement pas possible; et alors qu’il est demandé aux étudiants de produire un mémoire de Master avec un traitement de texte, très souvent ils achèvent leur scolarité de Licence (voire… de Master) sans en maîtriser les fonctionnalités indispensables à l’écriture d’un document long (usage des styles, tables des matières, voire index). Dès lors, lorsque vous disposez en tout et pour tout de quelques heures « d’atelier numérique » pour former une cohorte à l’usage d’un logiciel de bibliographie, aux outils de recherche en ligne et de veille informationnelle, voire (quand vous avez de la chance) aux fondamentaux de l’analyse quantitative, eh bien il ne reste pas beaucoup de place. Cela plaide, ici encore, pour l’intégration des enseignements dits « numériques » aux cours plus traditionnels [4]. Ce qui suppose néanmoins un accord collectif sur les compétences à acquérir dans une formation en Histoire… et au regard des réactions que peuvent parfois susciter le seul mot de « compétence » lorsqu’il s’agit de concevoir des maquettes de formation, il y a encore un peu de chemin à parcourir de ce côté-là.
C’est là qu’intervient une stratégie consistant à au moins permettre aux étudiants de savoir qu’il y a des alternatives, pour les orienter vers des ressources éventuelles s’ils souhaitent aller plus loin. C’est ce que j’appellerais la stratégie du « c’est toujours mieux que rien ». Je me répète sur ce point: formations, démonstrations et retours d’expériences me semblent toujours plus efficaces que les injonctions, surtout lorsque nous n’avons pas les moyens de nos ambitions. C’était dans cet esprit que, lorsque nous avions lancé nos formations à l’EHESS avec Franziska, nous avions organisé les sessions de présentation du soir pour permettre d’élargir la vision du champ des possibles pour nos étudiants. Nous formions à du très basique, mais les participants quittaient aussi la formation en ayant entendu parler, par exemple, de lexicométrie ou de blogging scientifique.
Du point de vue de l’écriture, je me suis longtemps cantonné à expliquer le fonctionnement du traitement de texte (en pensant à tort qu’avec la généralisation des formations bureautiques dans les universités cela ne serait pas nécessaire de le faire encore longtemps…). À ce titre, j’aime beaucoup commencer par faire lire aux étudiants cette citation de François Bon qui invite à « accorder son traitement de texte »:
En musique, j’aime tellement le moment où un musicien s’accorde. Pourtant, très peu de personnes règlent leur traitement de texte avant d’écrire. Par défaut, un logiciel de traitement de texte propose un réglage interligne simple, un interligne et demi, double interligne. Ces réglages viennent du temps des machines à écrire mécanique, où une roue dentée était actionnée par le levier manuel de retour à la ligne (poli et chromé, un plaisir). Mais ces règles ont un équivalent économique : dans le monde anglo-saxon, un auteur est rémunéré au nombre de mots, et les compteurs de nos traitements de texte actuels sont réglés par défaut à vous fournir le nombre de mots écrits (il s’affiche là à mesure que j’avance, en bas de mon écran), alors que nous sommes toujours éduqués, en France, à compter plutôt les caractères (espaces compris), ou bien qu’à chaque contrat signé avec un éditeur, un journal, un musée, on nous parle de feuillets, le feuillet étant censé comporter 25 lignes à double-interligne, soit environ 1750 caractères (espaces compris).
François Bon, « Après le livre | Accorder son traitement de texte », Tiers Livre Éditeur, 1e mise en ligne 13 novembre 2010 et dernière modification le 27 mars 2014
J’ai toutefois commencé à tenter de faire découvrir aux étudiants de Master l’existence d’alternatives/de compléments dans le cadre d’un enseignement à l’université de Lille. En réduisant la formation au TdT à une séance, je pouvais alors consacrer deux heures à un panorama très général sur les alternatives et les compléments. L’objectif de cette séance n’était pas de former les étudiants à ces outils, mais de leur permettre de découvrir qu’ils existent et qu’ils pourraient bien leur être utiles, tels les programmes de prise de note (type framanote et équivalents non libres type OneNote) ou logiciels d’écriture créative comme Scrivener (pour lequel j’avais la chance de pouvoir renvoyer à un retour d’expérience historienne grâce au billet de Caroline Muller ici même).
C’est dans ce cadre que je mentionnais simplement l’existence de LaTeX, en renvoyant d’emblée au guides de Maïeul Rouquette pour les SHS et d’Éric Guichard pour les SIC. Or, procéder ainsi, c’est parfois avoir la bonne surprise de voir un étudiant (avec quelques prédispositions) choisir d’aller plus loin, de « s’y coller pour voir » et finalement écrire son mémoire de Master avec autre chose qu’un traitement de texte… et encore mieux, d’y revenir dans non pas un mais deux billets!
Structurer et transformer
Mais pour des raisons pragmatiques (du temps disponible à mes propres lacunes), c’est surtout sur la syntaxe Markdown que j’insistais, histoire de familiariser facilement les participants avec la logique d’une écriture balisée/stucturée.
Cette syntaxe a été créée au milieu des années 2000 par John Gruber et Aaron Swartz. Ce dernier en annonçait la naissance sur son blog en mars 2004:
For months I’ve been working with John Gruber on a new project. The idea was to make writing simple web pages, and especially weblog entries, as easy as writing an email, by allowing you to use much the same syntax and converting it automatically into HTML. Together we pored over the syntax details from top to bottom, trying to develop the perfect format, and I think we’ve got something pretty darn great. We’ve tested it extensively: on our blogs, in my comments form, in our emails. It’s all worked amazingly well.
Aaron Swartz, 19 mars 2004 (www.aaronsw.com)
Si vous lisez régulièrement les billets que nous publions ici, vous savez probablement déjà que mon mantra en matière de formation pourrait se résumer à « les démarches avant les logiciels ». En effet, dans un environnement numérique instable, un logiciel ou une interface peut disparaître du jour au lendemain (coucou GReader), un logiciel libre peut devenir propriétaire, voire payant (c’est ce qu’avait tenté de faire Oracle avec OpenOffice… donnant ainsi naissance, en quelque sorte, à The Document Foundation et à LibreOffice), l’accès à une ressource ou un système payant si vous changez d’institution ou achevez vos études supérieures, etc.
Surtout, sauf à imposer aux étudiants d’utiliser tel OS, telle suite bureautique, tel logiciel, etc. nous devons en permanence jongler avec ce qui fonctionne ou non chez les uns ou les autres. Cela plaide bien sûr pour l’incitation à utiliser des logiciels libres multiplateformes. Mais, toujours par pragmatisme (et volonté ne pas totalement abandonner ceux que l’on arrive pas à convertir) cela mène parfois aussi à devoir apprendre à jongler d’un logiciel à l’autre… de Writer à Word en passant par Pages (eh si…) ou Google Doc [5].
Concernant l’initiation à une écriture structurée, la meilleure approche me semble avoir été formulée en deux tweets par Aurélien Berra :
Je crois aussi que le plus important est la logique de la structuration et la capacité de s’adapter à des besoins variables. En deux mots: structurer (quel que soit le format) et savoir transformer (pour répondre aux attentes des collaborateurs, des éditeurs…)
@aurelberra, tweet1; tweet2
Comment procéder ? En familiarisant les étudiants avec la syntaxe Markdown (et ses extensions) et avec le convertisseur de documents Pandoc. Pourquoi Markdown ? Parce qu’il s’agit d’une syntaxe dont il est très facile de se saisir. En une slide, vous pouvez donner à des étudiants toutes les bases nécessaires à la rédaction d’un premier document court.
Je ne les reproduis pas ici, vous les trouverez dans l’introduction à Markdown que Franziska avait publié ici même il y a 7 (!?) ans… Elle y résumais déjà très bien les arguments qui peuvent plaider pour le recours au texte brut:
Le texte brut a de très sérieux avantages sur le fichier de traitement de texte, en commençant par le risque bien moindre de corruption du fichier, en passant par la légèreté des fichiers obtenus, la pérennité du format et les possibilités d’accès et de modifications sur toutes plateformes, y compris téléphones portables.
(lire le billet)
En apprenant à écrire en Markdown, vous séparez l’étape d’écriture de celle de la mise en forme; vous vous assurez ainsi de pouvoir consulter vos contenus sans limite de temps. Essayez donc d’ouvrir avec LibreOffice, voire même avec un MS Office récent, un très vieux fichier Word écrit à l’époque où tout le monde utilisait une version crackée… Tentez donc de lire un fichier .pages alors que vous avez abandonné l’environnement MacOS. On pourrait multiplier les exemples. En outre, non seulement un fichier .md peut s’ouvrir avec n’importe quel éditeur de texte, mais de surcroît les fichiers sont très légers. Ce n’est pas seulement une question de place sur un disque dur, de performance et de pérennité… c’est aussi une question d’empreinte environnementale [6].
Mais surtout, l’autre avantage d’apprendre à utiliser Markdown, c’est que vous vous donnez ainsi la possibilité de séparer l’écriture, la structuration de votre pensée, de son format de restitution. Vous pouvez ainsi écrire votre texte comme vous le souhaitez sans vous soucier du format dans lequel vous devrez ensuite le rendre car en écrivant en Markdown, vous pourrez sans difficulté l’exporter ensuite en .html (comme le montre la citation plus haut c’était sa fonction de base); maus aussi: en .tex; dans un format de traitement de texte (.odt, .docx); et même en .pdf ! Pour cela, tout ce que vous aurez à faire, c’est vous familiariser avec Pandoc, logiciel de conversion de documents qui fonctionne, certes, en lignes de commandes, mais (ne fuyez pas !) le Web regorge de tutoriels et de conseils qui vous faciliteront grandement la vie. Et de plus en plus d’éditeurs Markdown comprennent des fonctionnalités d’export intégrés.
Habituellement, je ne dispose pas du temps nécessaire à une petite démonstration de Markdown pour mes étudiants de deuxième année. Avec le passage/la mise à distance des enseignements, tout en pensant que cela pourrait être utile aux Masters voire aux doctorants, j’ai décidé d’ajouter une petite démonstration dans la liste des tutoriels réalisés ce semestre… d’où ce long billet ; et d’où cette vidéo qui sera donc très prochainement mise en ligne accessible sur la chaîne de La boîte à outils (présentée dans un billet précédent) pour une démonstration très basique de l’utilisation de Markdown et Pandoc.
Pour aller plus loin
Voici une petite liste de ressources en guise de conclusion à ce billet:
- Pour vous familiariser avec la syntaxe, il existe de nombreuses pages… Celle-ci par exemple: « un guide pour bien commencer avec Markdown », par Fabrien Huet
- Pour découvrir Markdown en détail et toutes les possibilités de conversion avec Pandoc, ce document par Jean-Daniel Bonjour est l’un des plus complets et pédagogiques que j’ai pu consulter à ce jour : « Élaboration et conversion de documents avec Markdown et Pandoc«
- Le blog Zotero francophone a publié un billet présentant les possibilités offertes par l’age de Markdown et Zotero.
- Je vous recommande vivement le parcourir les sites de deux chercheurs, Arthur Perret et d’Antoine Fauchié, qui pensent ces enjeux d’écriture de façon bien plus large que ce qui est évoqué dans ce billet et qui reviennent régulièrement sur leur pratiques en donnant des conseils
- La série de vidéos (en anglais sans sous-titres) conçues par Nicholas Cifuentes-Goodbody vous permettra de faire un tour d’horizon très complet sur les possibilités offertes par Markdown et Pandoc pour l’écriture universitaire: « Academic Writing in Markdown »; Using Pandoc; et « What’s a bib file? »
- Raphael Kabo a présenté, en 2017/2018 une façon de travailler avec Markdown, Zotero puis Word dans « My workflow for transforming academic Markdown into beautiful Word documents » et en 2019 il a conçu un convertisseur DocDown présenté dans « Introducing DocDown, the easy way to turn academic Markdown into Word documents »
- La syntaxe Markdown peut être utilisée dans un environnement R, et vous permettre ainsi de documenter des scripts, etc. Je vous recommande vivement le billet « Une alternative à Word: écrire en RMarkdown », co-écrit par Alexandre Hobeika et Florent Bédécarrats sur le carnet Data Sciences sociales
- Apprendre à utiliser la syntaxe Markdown vous mènera probablement à vous intéresser d’un peu plus près à des initiatives permettant d’aller plus loin et de prendre toute la mesure des potentialités offertes aux SHS. À ce titre, je vous recommande vivement de jeter un oeil au projet « Stylo« , lancé en 2015 par Marcello Vitali-Rosati (voir An editor for academic papers (xml, html, md, TeX, pdf and if you really need it rtf), développé avec son équipe aus sein de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques et mis en ligne en 2018, il s’agit d’un « un éditeur de texte pour les sciences humaines et sociales »
Et bien sûr, que vous soyez étudiants ou enseignants, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur les outils que vous utilisez pour écrire et/ou ceux auxquels vous formez/vous vous formez. C’est des retours d’expériences que nous apprenons le plus ; c’est des pratiques des autres que l’on apprend ce que pourraient aussi être les nôtres… et que l’on se convainc parfois de sauter le pas vers de nouvelles méthodes.
Notes
[1] C’est ce que visait l’exercice que je faisais réaliser à l’EHESS et que j’ai poursuivi à Lille autour de l’écriture progressive d’un projet de recherche. Après avoir lu Écrire les sciences sociales d’Howard Becker (Économica, 2004) ce qu’il écrivait concernant un petit atelier d’écriture autour de morceaux de thèses m’avait conduit à imaginer un exercice dans lequel, progressivement, les étudiants rédigeraient un « projet de recherche » qu’ils me remettraient à plusieurs reprises pour commentaires et annotations, sur la base la méthode exposée dans ce billet sur Devenir historien·ne. C’est une expérience très formatrice, pour l’enseignant comme, je l’espère, pour les étudiants; qui rencontre malheureusement ses limites quand les groupes commencent à dépasser la vingtaine de membres…
[2] Pour aller plus loin sur ces questions, voir Isabelle Krzywkowski, Machines à écrire: Littérature et technologies du XIXe au XXIe siècle, Nouvelle édition en ligne. Grenoble: UGA Éditions, 2010]
[3]Voir aussi « Les chercheurs en SHS savent-ils écrire? Quelques réponses aux commentaires des lecteurs », Culture numérique, 13 mars 2018]
[4] J’ai déjà défendu cette position ici ou là; pour aller plus loin voir ce billet par Caroline Muller ainsi que celui-ci par Sébastien Poublanc].
[5]Bon, en revanche, les ChromeBooks il faudrait vraiment faire comprendre à tout le monde que ce ne sont pas des ordinateurs !]
[6] Ces préoccupations conduisent aussi à des transformations concernant notre rapport au Web… à ce titre, je vous encourage à lire les billets de Julie Blanc sur la refonte du site du Médialab de Sciences Po
Billet publié en parallèle sur la boîte à outils en source principale (rel=canonical) || source de l’image de une : nouvmethode p8 par patricia m en cc sur Flickr